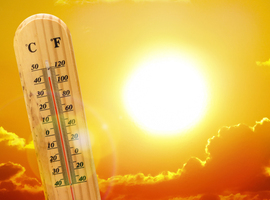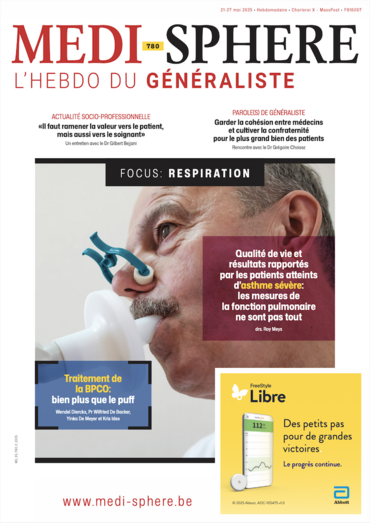Une étude interuniversitaire belge, récemment publiée dans BMC Primary Care, met en lumière les attentes des médecins généralistes en matière de collaboration interprofessionnelle. Elle révèle une préférence pour des équipes restreintes et bien coordonnées, mais pointe aussi plusieurs zones de tension, dans un contexte de réforme de la première ligne.
La médecine générale belge est confrontée à une pression croissante : vieillissement de la population, hausse des maladies chroniques, déserts médicaux… Face à ces défis, le gouvernement fédéral a lancé un « New Deal » pour encourager de nouveaux modèles d’organisation des soins de première ligne. C’est dans ce contexte qu’une étude qualitative , fruit d’une collaboration interuniversitaire coordonnée notamment par le Pr Jean-Luc Belche (ULiège), a interrogé 122 médecins généralistes de toutes les régions du pays sur leurs attentes en matière de collaboration interprofessionnelle. Cette étude visait à identifier les professionnels nécessaires pour soutenir les MG dans leur pratique quotidienne, à définir leurs rôles, et à explorer les conditions nécessaires à leur intégration dans un modèle de soins centré sur le MG.
Des équipes à taille humaine, centrées sur les fonctions clés
Les résultats, publiés le 27 mars 2025 dans BMC Primary Care, montrent une préférence claire des généralistes pour des équipes de petite taille, centrées autour d’infirmier·ère·s et d'assistants administratifs. La figure de l’assistant·e de pratique apparaît plus floue, à cheval entre soutien clinique et administratif. Ce modèle répond à une demande de proximité, d’agilité et d’autonomie dans le fonctionnement quotidien.
Parmi les conditions jugées essentielles à une collaboration efficace figurent le regroupement sur un même site, la définition claire des rôles, l’usage d’un dossier médical partagé, la coordination structurée des soins et une gestion logistique intégrée. Autant d’outils jugés indispensables pour faire vivre la multidisciplinarité au sein des pratiques.
Des zones de tension persistantes
Mais l’étude met aussi en évidence plusieurs points d'attention. La forte autonomie actuelle des pratiques constitue un frein au changement. Beaucoup de médecins tiennent à leur liberté d’organisation, et redoutent que des modèles plus intégrés ne limitent leur marge de manœuvre. Cette résistance est particulièrement marquée chez les praticiens travaillant en solo et à l'acte.
Par ailleurs, le rôle d’assistant·e de pratique suscite des interrogations. Perçu comme mal défini, il génère une certaine méfiance. Le flou entre tâches administratives et cliniques complique l’intégration de cette fonction dans les équipes, au risque de créer des malentendus ou des conflits de rôle.
La crainte d’un changement imposé
Plusieurs médecins expriment également leur inquiétude face à une réforme perçue comme descendante. La perspective de voir les autorités définir un modèle unique à suivre, sans concertation réelle, suscite des réserves. Ils redoutent que les incitants financiers et les exigences administratives du New Deal n’imposent une uniformisation des pratiques, au détriment des réalités locales.
La question du financement, bien que centrale dans la réforme en cours, n’a été que partiellement abordée dans les groupes de discussion. Les auteurs soulignent toutefois que le mode de rémunération actuel pourrait constituer un frein à certaines évolutions, notamment en matière de délégation de tâches ou de collaboration élargie.
Des attentes fortes envers les autres professions
L’étude souligne enfin l’importance de mieux cerner les représentations que se font les autres professionnels – infirmiers, assistants sociaux, pharmaciens – de leur place dans les soins de première ligne. Une collaboration efficace suppose un partage des tâches explicite, construit sur une confiance réciproque, et un dialogue structuré entre acteurs.
Une contribution universitaire au débat
Comme l’a publié le professeur Jean-Luc Belche dans un post sur LinkedIn « L'étude est le fruit d'une belle collaboration interuniversitaire, autour de questions incontournables qui concernent tous les acteurs de soins primaires/1ère ligne en Belgique, et qui touchent au fondement même de tout système de santé. Une manière pour les universités, au-delà de leurs rôles dans la formation, d'enrichir le débat sur les évolutions possibles du système de santé, au moment où elles sont discutées par les politiques et les représentants professionnels . »
> Lire aussi :
> HAD : les généralistes réclament qu’on réponde d'abord à leurs priorités de terrain
> Webinaire CMG : Découvrez le rôle de l'infirmier.e en pratique de médecine générale