Le recours aux techniques de procréation médicalement assistée a permis
à des milliers d’enfants de voir le jour en Belgique, et sans doute à des millions ailleurs dans le monde (1). Une avancée positive, incontestablement.
Mais à côté du droit des adultes de voir leur désir d’enfant réalisé, il convient de ne pas négliger les droits des enfants ainsi conçus. Dans ce contexte, l’objectif de cette contribution est de montrer que la législation belge actuelle, en prescrivant l’anonymat du don, a posé un choix qu’il est permis de critiquer au nom du droit de l’enfant de connaître ses origines, garanti notamment par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Notre propos se divise en 5 points: une brève introduction posant le contexte de la question, les termes du débat et la spécificité du questionnement identitaire des enfants issus d’une procréation médicalement assistée avec don, une présentation du système mis en place par le législateur belge en 2007, les prescriptions du droit international en la matière et, enfin, nos conclusions et recommandations.
Introduction
La procréation médicalement assistée (PMA) hétérologue, par opposition à la PMA homologue, mobilise l’apport de gamètes d’un tiers donneur (donneur de sperme ou donneuse d’ovocytes), voire de deux donneurs (donneur de sperme et donneuse d’ovocytes, couple donneur d’embryon surnuméraire). Le terme «donneur» en matière de PMA hétérologue peut donc viser l’homme qui fait don de son sperme, mais aussi la femme qui fait don de ses ovocytes ou le couple qui fait don d’un de ses embryons.
L’intervention d’un tiers dans la procréation produit un éclatement des composantes de la paternité et de la maternité. Le législateur, lorsqu’il autorise le recours aux techniques de PMA hétérologue, doit dès lors prendre position, notamment, sur le secret du mode de conception mais également sur les informations recueillies et éventuellement transmises à l’enfant concernant celui ou celle qui a participé à sa venue au monde. L’un des défis majeurs du droit des PMA tient précisément à la place de ce tiers donneur et amène nécessairement à se pencher sur la question de l’anonymat du don.
Les termes du débat: que cherche-t-on?
Aujourd’hui, les premiers enfants nés d’une PMA hétérologue se font entendre (2). Ils s’expriment dans les cabinets de professionnels (3), au sein d’associations (4), auprès des législateurs (5), dans la presse et les médias (6), devant les juridictions internes (7), voires internationales (8).
Les témoignages de ces jeunes adultes laissent apparaître un sentiment d’incomplétude, un vide générationnel, une rupture décisive tenant à l’effacement de la transmission de la vie (9). Ils ont le sentiment que leur histoire personnelle est «amputée», ils ressentent un «trou» dans leur filiation et éprouvent souvent le besoin de se comparer à «quelqu’un comme eux» (10). Ils peuvent également ressentir un sentiment profond d’injustice et de discrimination (11), sans aucun contrôle de la situation (12). Une partie de leur histoire leur échappe et leur est rendue légalement inaccessible. Leur souffrance est accentuée par le fait que quelqu’un (en l’occurrence une institution) en sait plus sur leur origine, leur intimité, qu’eux-mêmes (13). Ils contestent un système qui occulte complètement la réalité biologique de leur existence (14).
Très souvent, ces jeunes adultes témoignent d’une «part d’ombre» qui entrave leur construction identitaire et supportent difficilement de ne pouvoir visualiser leurs ressemblances physiques avec le donneur. La question de l’apparence physique est ainsi récurrente, de sorte que bon nombre d’entre eux souhaiteraient simplement disposer d’une photo du donneur (15), sans nécessairement vouloir connaître son identité ou le rencontrer. La question des autres enfants conçus avec les paillettes de sperme du même donneur est également très fréquente, avec, en toile de fond, la peur d’une rencontre incestueuse (16).
La question de la loyauté des enfants issus de la PMA à l’égard de celui qui, par un don, leur a permis de voir le jour, est également souvent exprimée. S’ils sont évidemment redevables à l’égard de leurs parents qui les ont
aimés et élevés, ils se sentent aussi redevables envers ceux qui leur ont transmis la vie et ils peuvent éprouver le
besoin de leur exprimer (17).
Il est également important de relever que ces enfants ne sont à la recherche que de leur géniteur ou génitrice, c’est-à-dire d’une part de leur identité, et en aucune façon d’un père ou d’une mère. Conçu par insémination artificielle avec donneur en France, Arthur Kermalvezen pose de manière claire les termes du débat: «En militant pour le droit d’accès à mes origines, je ne reproche pas aux médecins d’être né dans la famille qui est la mienne ni d’avoir les parents que j’ai (18).» Au contraire, l’auteur reconnaît son père comme étant l’homme qui l’a élevé. Et pour se justifier encore à l’égard de ceux qui veulent voir dans sa démarche la volonté de «retrouver» un père dans la personne du donneur, il répond: «Ce n’est pas parce que je cherche une part de ma filiation génétique que je rejette ma filiation juridique et sociale. J’aime la famille dans laquelle j’ai grandi et j’aime particulièrement mon père. J’ai une histoire dans cette famille-là et pas dans une autre. […] Mon père, c’est celui que ma mère a désigné comme père de ses enfants. C’est celui qui m’a donné son nom. C’est lui qui s’est coltiné mon éducation, qui m’a mis la pression pour les études et qui m’a donné le goût des challenges. C’est l’homme passionné de langage qui m’a appris à choisir mes mots,
celui-là plutôt qu’un autre, l’homme que j’ai voulu dépasser pour me construire (19).»
Il n’y a ainsi, dans le chef d’Arthur Kermalvezen, aucune confusion entre son géniteur et son père, mais si le second est incontestablement plus important pour lui que le premier, le géniteur ne cesse pas d’exister pour autant.
Que prévoit la loi belge?
En Belgique, la loi (20) autorise, à titre gratuit, le don de sperme, d’ovocytes et d’embryons. Les parents, au sens juridique du terme, sont les auteurs du projet parental. Il est donc impossible d’établir un lien de filiation entre l’enfant né grâce à un don et le donneur ou les donneurs de gamètes ou d’embryons.
Quant à l’anonymat du donneur, la loi établit une distinction entre le don de gamètes et le don d’embryons. Elle impose l’anonymat pour ce dernier mais autorise le don non anonyme de gamètes lorsqu’il résulte d’un accord entre le donneur et le ou les receveurs (21). Toutefois, l’anonymat n’est dans ce cas levé qu’entre le donneur et la receveuse ou le couple receveur. Hormis par l’intermédiaire de ses parents, l’enfant né à la suite d’un don non anonyme de gamètes n’a aucun droit d’accès aux informations relatives au donneur. D’une part, l’enfant ne dispose d’aucun recours pour forcer ses parents à lui communiquer les informations dont ils disposent; d’autre part, le centre de fécondation reste tenu de rendre inaccessible toute donnée permettant l’identification du donneur, que le don soit anonyme ou non, et toute personne travaillant pour ou dans un tel centre qui prend connaissance, de quelque manière que ce soit, d’informations permettant l’identification des donneurs d’embryons ou de gamètes est tenue au secret professionnel (22). Dès lors, aucune information identifiante ne peut être communiquée par le centre de fécondation. Concernant les informations non identifiantes relatives au donneur (taille, âge, poids, profession, centres d’intérêts, état de santé,…), le centre de fécondation ne peut communiquer que les informations de nature médicale susceptibles de revêtir une importance
pour le développement sain de l’enfant et, surtout, il ne peut communiquer ces informations qu’à la receveuse ou au couple receveur qui en fait la demande au moment de faire un choix ou au médecin traitant de l’enfant, de la receveuse ou du couple receveur, pour autant que la santé de l’enfant le requière (23).
Force est dès lors de constater qu’en organisant de la sorte la «disparition» du donneur, le droit belge confisque délibérément à l’enfant une partie de ses origines et méconnaît de la sorte ses engagements internationaux.
Que prévoient les instruments internationaux?
L’article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l’Enfant (CIDE), ratifiée par la Belgique, dispose que dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant doit être pris en considération de manière primordiale. Cette prise en compte de l’intérêt de l’enfant impose à tout le moins de respecter les droits qui lui sont reconnus par la CIDE. À cet égard, on relèvera que l’article 7.1 de la CIDE dispose que «[l]’enfant est enregistré dès sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux». L’article 8 consacre quant à lui le droit de l’enfant à la
préservation de son identité.
S’il est évident que le libellé de l’article 7.1 de la CIDE peut donner lieu à des interprétations divergentes (qui sont les «parents», que signifie «dans la mesure du possible»?), il n’en reste pas moins que le Comité des droits de l’enfant a adopté sur la question une position dépourvue d’ambiguïté. Se fondant sur l’article 7.1 mais aussi sur les articles 3.1 et 8 de la CIDE, il considère que le droit pour un enfant de connaître ses parents est dénié par les États parties qui autorisent l’accouchement anonyme, les boîtes à bébés, le secret de l’adoption mais aussi l’anonymat du don de gamètes ou d’embryons. Ainsi, dans ses observations finales rendues à l’égard de l’Irlande le 1er mars 2016, le Comité recommandait à l’État partie de veiller à ce que l’intérêt supérieur des enfants nés grâce aux techniques de PMA soit une considération primordiale et à ce que ces enfants aient accès à des informations sur leurs origines (24). Le 23 février 2016, il demandait à la France de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au droit de l’enfant de connaître ses parents biologiques ainsi que ses frères et sœurs et la priait instamment d’adopter les mesures nécessaires pour que toutes les informations concernant le ou les parents soient enregistrées et archivées afin que l’enfant puisse connaître, pour autant que possible et à un moment adéquat, son ou ses parents (25). Le 9 octobre 2002, le Comité adoptait déjà la même position à l’égard du Royaume-Uni, relevant avec préoccupation que les enfants nés d’une fécondation médicalement assistée n’avaient, à l’époque (26), pas le droit de connaître l’identité de leurs parents biologiques (27).
Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que la CIDE vise la protection de l’enfant, au sens de «tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable» (28). Si l’on peut certes défendre l’idée que certains droits de l’enfant devraient idéalement être reconnus de la même manière aux adultes (29), il reste qu’une interprétation respectueuse de la CIDE interdit d’étendre l’application des droits qu’elle consacre à une personne devenue majeure. C’est alors vers la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qu’il convient de se tourner.
La Cour européenne des droits de l’Homme a développé sa jurisprudence sur la question de l’accès aux origines personnelles sous l’angle de l’article 8 de la Convention, et plus précisément du droit au respect de la vie privée. Elle considère que «le respect de la vie privée protège le droit à l’identité et à l’épanouissement personnel». Pour la Cour, le droit à l’identité fait même partie du «noyau dur du droit au respect de la vie privée» (30), en ce qu’il est une condition essentielle du droit à l’autonomie (31) et à l’épanouissement (32). La Cour qualifie ainsi de «vital» l’intérêt de l’enfant, même devenu adulte, à obtenir les informations qui lui sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de son identité
personnelle, dont l’identité de ses géniteurs fait partie.
Le respect de la vie privée exige, aux yeux de la Cour, qu’une personne puisse accéder aux informations lui permettant d’établir «quelques racines de son histoire». La Cour a ainsi reconnu, sur cette base, le droit pour un individu d’avoir accès aux informations relatives à sa petite enfance contenues dans un dossier de l’assistance publique (arrêt Gaskin [33]), le droit de connaître ses origines et les circonstances de sa naissance (arrêts Odièvre [34] et Godelli [35]) et le droit pour un enfant, fût-il âgé, d’avoir accès à la certitude de sa filiation paternelle (arrêt Jäggi [36]). Si la Cour ne s’est pas encore expressément prononcée sur la question de l’anonymat du donneur de gamètes, cela ne saurait tarder, une requête contre la France étant actuellement pendante devant la juridiction strasbourgeoise.
Conclusions et recommandations
Une conclusion s’impose: aborder sereinement le débat sur la levée de l’anonymat dans le contexte de la mobilisation d’un tiers dans le projet parental d’autrui nécessite de distinguer le registre des origines de celui de la parenté, au sens de la filiation instituée par le droit.
La tendance actuelle en Europe est nettement à la levée de l’anonymat du don au nom du droit de l’enfant d’accéder à ses origines personnelles. On relèvera à cet égard que dans les États qui ont accepté de lever, à des degrés divers, l’anonymat du donneur, la place des parents légaux de l’enfant n’est jamais menacée (37). L’identification du donneur n’implique aucunement dans son chef un statut de père ou de mère (38). Les statuts respectifs de donneur, d’une part, de «receveur-parent», d’autre part, peuvent donc coexister dès lors qu’il ne s’agit aucunement de situer le donneur dans un registre de parenté ou de parentalité, mais dans un registre d’origines (39).
Cette reconnaissance symbolique par le droit de la participation d’un tiers dans la procréation permet de ne pas nier une partie des origines de l’enfant. Celui-ci se voit reconnaître, s’il en éprouve le besoin (40), un droit tantôt absolu (41), tantôt relatif (42), d’accéder aux informations relatives à la personne qui a aussi contribué à sa venue au monde (43), sans qu’aucun effet juridique n’en découle. Lever le secret n’implique donc en rien une dévalorisation de la place et du rôle des auteurs du projet parental, ni une menace de leur statut, mais permet de ne pas nier la réalité de l’engendrement et de restituer cette réalité à l’enfant (44). Il ne s’agit donc pas, comme d’aucuns aiment à l’imaginer, de solliciter du donneur une quelconque responsabilité parentale mais simplement de ne pas nier son existence. Il ne s’agit pas non plus de
valoriser de manière excessive la filiation génétique au détriment de la filiation éducative mais de comprendre les effets délétères de la dynamique du secret.
Nous plaidons dès lors pour une modification de la
loi belge dans le sens d’une levée de l’anonymat et appelons à la mise en place d’un système de recueil systématique des données concernant les donneurs, qui devrait au minimum porter sur les informations médicales susceptibles de s’avérer importantes pour le développement sain de l’enfant – ce qui est déjà le cas actuellement –, mais aussi sur les caractéristiques physiques du donneur, sa formation, sa profession, son âge, sa situation familiale, ainsi que toute autre information que celui-ci souhaiterait laisser, telle une description établie par lui-même en référence à une liste de caractéristiques ou encore un résumé de ses motivations ou une explication sur son
intervention dans le processus de procréation. Dans la mesure où la divulgation de ces informations ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée du donneur, elles devraient automatiquement être communiquées à l’enfant mineur qui en fait la demande, accompagné de ses parents, voire seul à partir d’un certain âge. À sa majorité, ou même avant, eu égard à son degré de maturité, l’enfant pourrait également solliciter l’accès à l’identité du donneur. Enfin, l’enfant devrait également avoir la possibilité de s’adresser à une instance officielle pour obtenir l’identité des autres enfants issus du même donneur, si ceux-ci y consentent.
L’enfant porte en son corps la marque de la rencontre d’un homme et d’une femme, et la pluralité de ce corps s’accentue lorsque parents et géniteurs sont différents. L’intérêt de l’enfant commande alors de donner à chacun son dû. Lorsqu’existe une dissociation entre la filiation juridique et les origines génétiques de l’enfant, la norme doit pouvoir aménager la coexistence de ces deux dimensions fondatrices de l’individu. Car si le respect de la
dignité humaine implique nécessairement de ne pas réduire la personne à son origine génétique, pareille réduction emportant une négation d’une partie de son identité, il n’est pas plus acceptable d’évacuer complètement la
dimension corporelle de l’être humain.
Références sur demande
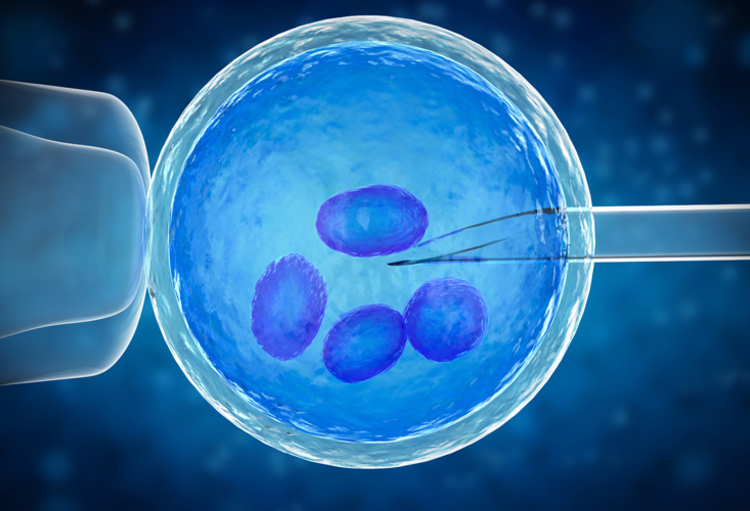









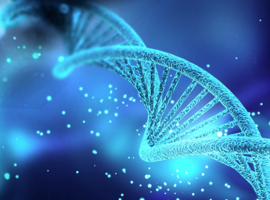
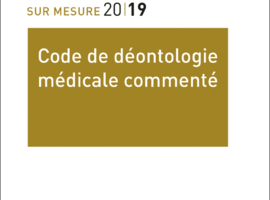

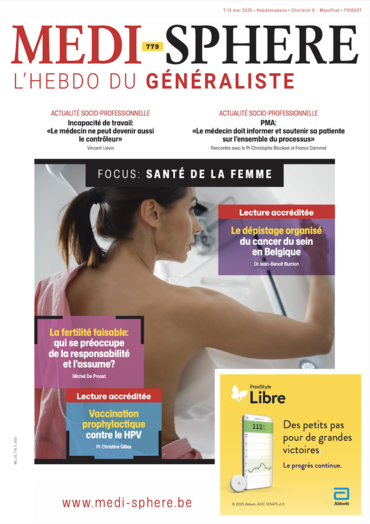








Derniers commentaires
Jacek Sierakowski
18 février 2019"Voires"?