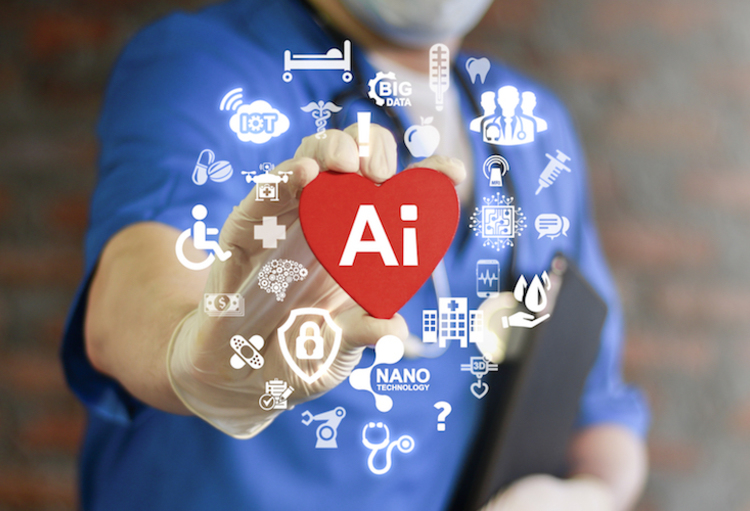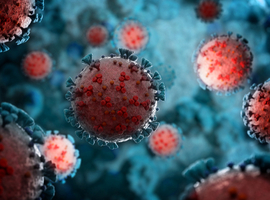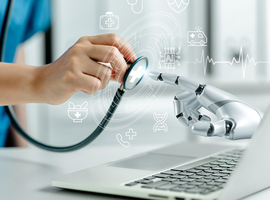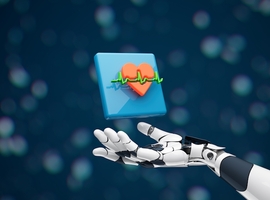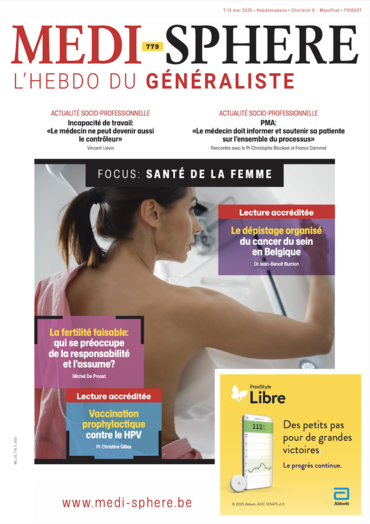L’accord gouvernemental belge "Arizona" (2025-2029) prévoit un encadrement renforcé de l’intelligence artificielle (IA) et du numérique dans le secteur de la santé. Plusieurs mesures visent à structurer l’usage de ces technologies afin d’améliorer l’organisation des soins, tout en garantissant la protection des données et en évitant une automatisation excessive au détriment du rôle des professionnels de santé.
Les intentions du gouvernement s’inscrivent dans un cadre européen plus large, mais des incertitudes demeurent quant à leur mise en œuvre concrète. Néanmoins, l’ambition de ce gouvernement en matière de santé et de numérique est certainement louable, et les leçons tirées du précédent gouvernement apparaissent clairement dans le nouvel accord.
Un cadre réglementaire national sur l’IA en santé
L’accord prévoit de compléter la réglementation européenne par des règles spécifiques à la Belgique pour encadrer le développement et l’usage de l’IA dans les soins de santé (p. 122). Il s’agit notamment de garantir :
- La protection des données médicales et du secret professionnel.
- Le respect de la relation thérapeutique entre médecin et patient, l’IA étant considérée comme un outil d’appui et non un substitut au contact humain.
- Un espace d’expérimentation pour les nouvelles applications d’IA, sous réserve du respect de la qualité des soins.
L’idée d’un encadrement national supplémentaire peut paraître justifiée pour adapter les règles aux spécificités du système de santé belge. Toutefois, le risque est de créer un cadre réglementaire trop complexe ou déconnecté des standards européens, ce qui pourrait freiner l’adoption de certaines innovations. D’un autre côté, l’expertise belge pourrait également compenser certains manquements de l’AI Act dans le milieu médical.
Les données de santé et l’accès numérique
Le partage et la réutilisation des données médicales sont des enjeux majeurs de la politique numérique en santé (p. 126). L’accord prévoit plusieurs évolutions :
- Un accès facilité aux données de santé pour les patients, leur permettant de mieux suivre leur état de santé et de limiter certains déplacements inutiles.
- L’interopérabilité des plateformes médicales afin d’assurer une continuité des soins entre les différents acteurs de santé.
- L’institutionnalisation de l’Agence belge des données de santé (HDA), chargée de faciliter l’accès aux données pour la recherche et l’élaboration des politiques publiques.
Un point notable est la proposition de permettre aux citoyens de faire "don" de leurs données médicales pour la recherche, sur un modèle inspiré du don d’organes. Cette disposition soulève des questions importantes sur les garanties de confidentialité et sur la manière dont le consentement sera obtenu et encadré. Notons par ailleurs que certaines organisations belges, comme le Belgian Brain Council, sont déjà à l'avant-garde en la matière.
Par ailleurs, la fragmentation actuelle des dossiers médicaux en Belgique reste un problème. L’accord évoque la nécessité d’un dossier patient électronique mieux intégré et accessible aux soignants, mais sans préciser comment surmonter les obstacles techniques et administratifs qui persistent. Peut-être l’accord fait-il référence à l’effort que nous avons mené avec le groupe d’experts derrière le concept de BIHR (Belgian Integrated Health Record) ?
L’IA et la gestion des soins
L’accord met en avant plusieurs applications de l’IA et du numérique pour faciliter la gestion des soins et alléger la charge des soignants (p. 122) :
- Automatisation de certaines tâches administratives pour libérer du temps médical.
- Suivi des maladies chroniques et télésurveillance pour éviter des hospitalisations inutiles.
- Meilleure structuration des données de santé pour améliorer la qualité des soins.
L’un des défis liés à ces points sera de voir comment le renforcement du concept d’hospitalisation à domicile s’insérera dans le contexte actuel de pénurie de soignants et d’organisation des soins, ainsi que la question du remboursement, du nombre de cas d’usage et du choix des technologies adaptées. L’efficacité de ces dispositifs dépendra donc de leur ergonomie et de leur intégration dans le quotidien des professionnels de santé.
Le texte prévoit aussi un soutien à l’innovation dans les applications médicales numériques. Il est question d’un guichet unique pour les développeurs et d’une procédure de remboursement temporaire pour certaines technologies, à condition que leur intérêt clinique soit démontré, avec un remaniement de la pyramide de validation mHealth existante.
En résumé, quelques questionnements en suspens :
- Comment l’adoption d’un cadre réglementaire national sur l’IA en santé pourra-t-elle éviter de compliquer inutilement l’adoption des innovations tout en corrigeant les défaillances du cadre européen (AI Act) ?
- Comment le gouvernement va-t-il gérer l’intégration et l’interopérabilité des systèmes de données médicales ? Quelques hypothèses sont plausibles sur la base des efforts passés, notamment par rapport aux standards FHIR pour l’usage primaire, OHDSI pour l’usage secondaire, et les terminologies telles que SNOMED-CT.
- Comment le gouvernement étendra-t-il les critères du monitoring à distance et gérera-t-il l’évaluation de l’efficacité des outils numériques pour les soignants, leur conception et leur ergonomie ?
- Comment le gouvernement spécifiera-t-il le "don de données" pour la recherche, qui devra être encadré de manière stricte afin d’éviter toute ambiguïté sur l’usage des informations personnelles ?
Mais la question importante reste : quel budget le gouvernement accordera-t-il réellement au remboursement des technologies ? Et aussi comment le gouvernement va-t-il gérer la validation sur le sol belge des technologies numériques (notamment l’IA) destinées aux patients ?
> Découvrir la déclaration du formateur
Lire aussi :
> Les autre usages de l’IA dans l’accord "Arizona"
> IA et santé numérique: l’urgence de l’ambition (Prof Giovanni Briganti)