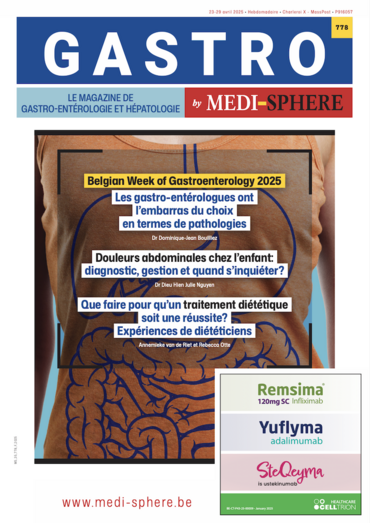Le 19 mars, la Société Balint Belge essaiera d’arrêter le temps, histoire d’en discuter. Dans le prolongement du thème examiné l’an dernier – la sollicitude –, elle questionne la durée qu’il faut préserver à un soin pour le rendre (plus) humain. Une médecine de qualité s’accommode-t-elle de cadences soutenues? Peut-elle rimer avec productivité?
Peut-on, dans le soin, faire les choses vite et (néanmoins) bien? Faut-il forcément consacrer beaucoup de temps, pour que la relation avec le patient, la démarche diagnostique et thérapeutique, soient bonnes? Est-ce que le temps tient dans une enveloppe, comme on semble l’admettre désormais en plaquant des durées sur les actes: la toilette d’un patient ou d’un résident, c’est autant de minutes; le séjour hospitalier pour telle pathologie, c’est autant de jours… Telles sont quelques-unes des questions qui, détaille le Dr Michèle Parée, animatrice Balint, seront soulevées à Liège, le samedi 19 mars lors du traditionnel «Printemps Balint», le 13ème du nom.
La gestion du temps est un véritable exercice de corde raide pour bien des médecins généralistes, tiraillés entre l’écoute du patient qui après une première plainte banale, enchaîne sur deux-trois autres préoccupations, et la nécessité de ne pas laisser les autres personnes poireauter indéfiniment en salle d’attente. «Cela suppose de réussir, sur le quart d’heure de consultation, à prendre en compte à la fois son interlocuteur, le patient suivant et soi-même. Bien sûr, je peux choisir d’avancer, me concentrer sur la première question, ne pas chercher à déceler sous le vernis le véritable motif de consultation – qui peut être, par exemple, la crainte de développer un cancer, exacerbée par un récent décès causé par la maladie dans un cercle d’amis. Si je n’ai pas pris le temps d’approfondir, le patient va m’échapper, se tourner vers d’autres interlocuteurs et peut-être pas à bon escient, parce que son angoisse n’aura pas été entendue», illustre le Dr Parée.
Mais, à côté de son souci d’appréhender la complexité d’un cas, d’une personnalité, le praticien doit se préserver également lui-même, surtout en cette période de poches de pénurie en MG qui, par endroits, contraignent les médecins toujours actifs à refuser des demandes, sous peine de tomber dans le surrégime, avec ses répercussions physiques et psychiques. «Même si ce n’est pas évident, il faut se montrer plus cadrant, mettre des balises. Par exemple, proposer au patient à plaintes multiples d’en aborder une à la fois, ce qui va peut-être l’amener avant son passage suivant à faire un tri entre l’anecdotique et le réellement important.»
Outre l’épuisement professionnel auquel on s’expose quand on exerce sans se fixer de limites, c’est la motivation qui est en jeu si on verse dans l’expéditif. «C’est un phénomène que les infirmières rapportent souvent. Elles doivent faire beaucoup en peu de temps. Alors elles s’exécutent, sans que ce soit satisfaisant, en n’allant pas en profondeur, en en retirant le sentiment que ce n’est pas porteur sur le long terme. Il leur manque le temps de la prise de recul, de l’arrêt pour réfléchir au sens de ce qu’on fait.»
Pour ceux qui ne le connaissent pas, le «Printemps Balint» est un séminaire ouvert à tous les professionnels de la santé, n’ayant pas forcément d’expérience de l’approche Balint, laquelle tend à améliorer sans cesse la relation soignant-soigné. Le travail se fait par petits groupes, sous la houlette d’animateurs, en partant de cas vécus dans la pratique et en explorant la situation de soin. Détails sur l’approche et sur le rendez-vous du 19 mars sur www.balint.be. Il connaîtra un prolongement lors de la journée annuelle d’étude du 19 novembre.